Séquencer le génome du coronavirus: l'opération est cruciale pour contrôler l'épidémie de Covid-19, en repérant l'apparition de nouvelles souches. Mais la France en fait très peu, poussant chercheurs à s'inquiéter et laboratoires privés à proposer leurs services à l'Etat.
"La France a énormément de retard sur ce sujet", regrettait en début de semaine l'épidémiologiste Samuel Alizon, dans un entretien au site The Conversation.
Qu'est-ce que le séquençage ? C'est une opération qui consiste à dresser un portrait détaillé du virus, via son génome, après l'avoir dépisté chez une personne infectée.
En le faisant à grande échelle, on repère l'apparition de nouvelles souches comme le variants britannique, brésilien ou sud-africains détectés depuis fin 2020 et probablement plus contagieux que les premières lignées du virus.
C'est donc un outil essentiel pour maîtriser l'épidémie. Mais, en France "après (des) débuts encourageants, le séquençage s'est arrêté presque aussi net", regrette M. Alizon.
Sur l'ensemble des personnes testées positives au coronavirus en France, environ 0,15% ont fait à ce jour l'objet d'un séquençage, selon Gisaid, la base de données de référence alimentée par des chercheurs à travers le monde.
Même si de nombreux autres pays sont à la traîne, comme l'Allemagne et l'Italie, cette proportion contraste avec des pays pratiquant un séquençage plus intensif comme le Danemark - 20% - et le Royaume-Uni - 5%.
Depuis quelques jours, plusieurs chercheurs, comme M. Alizon, accentuent leurs critiques sur ce retard, donnant aux opposants au gouvernement l'occasion d'une nouvelle polémique après celle sur la lenteur supposée de la campagne de vaccination française.
"Voici le nouvel épisode de la saga des défauts d'anticipation du gouvernement: (...) une nouvelle fois, la France est en retard", accusait mardi à l'Assemblée la députée de droite (LR) Emmanuelle Anthoine, interpellant le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Celui-ci s'est défendu d'un suivi insuffisant de l'épidémie en soulignant que des opérations de "criblage" du coronavirus étaient déjà menées à grande échelle.
Elles ont, ainsi, permis d'établir la présence importante de plusieurs nouvelles souches - sud-africaine et brésilienne - en Moselle.
- Manque d'investissement -
Mais le criblage n'est pas le séquençage. C'est une opération bien plus partielle, qui ne permet que d'identifier des variants déjà connus.
"Les complétement nouveaux, vous ne les voyez pas et les variants de la variante, vous ne les voyez pas non plus", souligne auprès de l'AFP le généticien Philippe Froguel.
"Si ce variant mute, ça vous ne le voyez pas: c'est le séquençage qui vous le dira", insiste-t-il, notant en outre que le criblage tend à donner une image déformée de la réalité en surestimant la présence des variants connus.
Les propos de M. Véran ne sont pas, pour autant, totalement hors de propos. Le criblage permet de prendre des mesures d'urgence, comme l'envoi de doses supplémentaires de vaccins en Moselle.
Mais, pour éviter d'être pris de court par l'apparition d'une souche plus contagieuse ou plus mortelle chez l'individu, le séquençage donne bien plus de visibilité.
Pour être efficace, ce n'est pas la peine de séquencer tous les cas positifs mais seulement un échantillon représentatif. M. Froguel juge ainsi que 5% serait suffisant.
On en est loin, une situation attribuée par plusieurs chercheurs à un manque d'investissement public de longue date en la matière, qui se traduit actuellement par un manque de personnel et d'efficacité technique.
Dans ce contexte, des laboratoires privés expriment leur volonté de participer plus avant à ces opérations de séquençage, pour l'essentiel menées par des instituts publics de recherche.
"Nous souhaitons vraiment contribuer de manière active à cette recherche épidémiologique pour traquer les nouveaux variants de demain", déclarait lundi sur Franceinfo Sylvie Cado, PDG des laboratoires Cerba.
"Nous pouvons séquencer jusqu'à 500 échantillons par semaine, ce qui permet vraiment une surveillance épidémique de qualité", a-t-elle détaillé.
Mais cette implication du privé ne serait, de toute façon, pas gratuite pour l'Etat et, donc le contribuable: "on souhaitera être rémunérés", a prévenu Mme Cado, évaluant à au moins 150 euros le coût d'un séquençage.
Interrogé par l'AFP sur le sujet d'une collaboration plus avancée avec le privé, le ministère de la Santé n'a pas répondu, rappelant juste que les laboratoires étaient déjà autorisés à effectuer des séquençages.
jdy/ico/nth


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
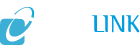
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)