Largement minoritaires en prison où elles ne représentent que 3,3% des quelque 63.000 détenus, les femmes sont souvent isolées et souffrent d'une "invisibilisation" dans un univers carcéral pensé pour les hommes et où la mixité reste l'exception.
Au 1er février, 2.119 femmes étaient incarcérées en France contre 61.683 hommes. La proportion de détenues se stabilise depuis plusieurs années autour de 3,5% et n'a jamais dépassé en quarante ans les 4,5% selon les données statistiques du ministère de la Justice.
"On pourrait s'imaginer que, puisqu'elles sont moins nombreuses, cela va mieux pour elles, mais c'est tout le contraire", pointe Dominique Simonnot, à la tête du contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL).
Cette autorité indépendante avait, il y a cinq ans, rendu un avis très critique sur les conditions de détention des femmes. Elles "ne bénéficient pas des mêmes droits que les hommes privés de liberté", écrivait l'ex-contrôleure Adeline Hazan, évoquant une "forme de double peine".
Première des discriminations, le difficile maintien des liens familiaux.
"Souvent les femmes délinquantes ont été en rupture familiale très tôt, elles sont déjà plus isolées de leurs familles", souligne la sociologue Corinne Rostaing. Et quand elles "tombent" pour une infraction, elles sont fréquemment délaissées par leurs compagnons, à la différence des "mères, soeurs et femmes" qui continuent de rendre visite aux détenus hommes.
La répartition géographique des centres de détention pour femmes peut aussi éloigner: ils sont majoritairement situés dans la moitié nord de la France.
Et cet isolement est en plus renforcé par la configuration même des établissements pénitentiaires: hormis deux - sur 56 - qui leur sont entièrement dédiés, à Rennes et Versailles, les femmes restent "enclavées" dans des petits quartiers spécifiques au sein de prisons pour hommes, et qui parfois ne comptent qu'une poignée de places.
Elles ne sont parfois que trois, quatre ou cinq dans une prison, "et c'est toujours au bout d'immenses couloirs, dans un coin, en marge", affirme Corinne Rostaing.
Leur faible nombre n'est pas synonyme de meilleures conditions de détention: au 1er février, quatorze quartiers femmes étaient en état de surpopulation, celle-ci atteignant notamment 168,2% à Bordeaux-Gradignan ou 136,7% à Orléans-Saran.
- "Pas de bruit" -Femmes et hommes détenus n'ont pas toujours été strictement séparés. Ce n'est qu'à partir de 1830 que la non-mixité s'est progressivement généralisée en prison, et où elle s'est maintenue, contrairement à l'école et à l'hôpital, relève Corinne Rostaing.
Parce qu'elles ne peuvent pas croiser d'hommes en détention et qu'elles sont moins nombreuses, elles ont un accès réduit aux soins, aux activités, aux formations ou au travail.
Pour les soins gynécologiques, moins de la moitié des établissements pénitentiaires proposent aux femmes une consultation sur place, selon une enquête de la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP) en 2017.
Et il aura fallu attendre octobre 2020 pour que soient fournies des protections périodiques gratuites, un retard "assez symptomatique de comment fonctionne le système", estime François Bès, de l'Observatoire international des prisons (OIP).
Depuis le déploiement du "plan de lutte" contre la précarité menstruelle en détention, 11.886 paquets de protections périodiques ont été distribués, précise le ministère de la Justice.
Pour réduire ces inégalités hommes-femmes, notamment en terme d'insertion socio-économique, la loi pénitentiaire de 2009 a introduit la possibilité d'activités mixtes en prison. Mais plus de dix ans après, cela reste "anecdotique", déplore l'OIP.
Elles représentent en effet "4% de l'ensemble des activités" organisées en détention, selon la DAP. La mixité a été introduite pour les "cours dispensés par l'Education nationale", ou lors d'activités de travail ou de formation professionnelle.
Les "contraintes organisationnelles" et les "freins matériels" ont souvent été mis en avant pour expliquer le lent développement de cette mixité. L'administration pénitentiaire a souhaité en "définir objectivement" les avantages, à travers un groupe de travail. Ses travaux sont toujours en cours.
"Ce qui manque aux femmes" finalement, dit la sociologue Corinne Rostaing, c'est qu'"elles ne font pas peur" et "pas de bruit". "Et même quand elles font du bruit, on ne les entend pas".
asl/mdh/pga/caz


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
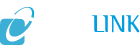
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)