Ils ont plongé dans une violence paroxystique à laquelle ils n'étaient pas préparés, munis d'un mandat aussi vague qu'inadapté. Et de retour en France, ils ont été stigmatisés: l'armée française ne digère pas d'être mise en cause au Rwanda.
C'est une plaie profonde et encore douloureuse que le chef d'état-major, le général François Lecointre, décrivait dimanche en évoquant l'opération Turquoise en 1994. Une mission à laquelle participent 2.500 soldats dont le capitaine Lecointre, censée accomplir une mission humanitaire mais considérée par ses détracteurs comme ayant permis de protéger les auteurs du génocide.
"Il est fou d'imaginer que les soldats qui ont été engagés dans Turquoise y allaient pour autre chose que pour arrêter le massacre des Tutsi par les Hutu", a-t-il déclaré sur la chaine BFM TV. "C'est complètement inconséquent, insensé d'imaginer autre chose. C'est une injure faite à nos soldats".
Presque 30 ans plus tard, le rapport Duclert sur le rôle de la France dans le génocide, remis vendredi à Emmanuel Macron, aide à comprendre pourquoi ce passé ne passe pas.
Description du lieutenant-colonel Duval, fin juin 1994: "... la chasse aux Tutsi a lieu tous les jours menée par des éléments de l'armée, gendarmerie, milices encadrant la population. Ils nous ont montré des cadavres de la veille et du jour même".
Les auteurs de ces massacres sont encadrés par des forces de l'ordre rwandaises qui ont été armées par la France et, pour certaines, formées par elle les années précédant les tueries. Alors, en parcourant le pays des mille collines, les Français sont acclamés par les assassins.
"Il est à noter qu'un véhicule contenant des militaires FAR (Forces armées rwandaises fidèles au régime hutu) (...) affichait un grand drapeau français sur le capot", souligne le lieutenant-colonel Duval.
- "Mais c'est un tueur" -
Sous couvert de l'anonymat, un ancien officier de l'armée de terre décrit à l'AFP l'impossible prise de conscience, pour les soldats, de ce qui se passe devant leurs yeux.
"Quand vous faites de la coopération militaire, vous formez des cadres et nouez des liens avec eux. Ils vont devenir des copains", explique-t-il. Mais le copain n'est pas toujours celui qu'on croit. "C'est comme si on vous disait que votre voisin est un tueur en série. Vous avez bu le café avec lui, il est sympa, il est gentil avec les enfants. Mais c'est un tueur...".
Le rapport Duclert, de fait, épargne la plupart des hommes sur le terrain. "Peu à peu dépassés par le nombre et la gravité des blessés, (les soldats) font preuve d'un sang-froid exceptionnel dans leurs actes de soin d'urgence", estime-t-il. Il décrit leur stupeur face à "l'odeur abominable" et aux survivants qui ne pleurent ni ne crient. Un silence qui est "sans nul doute une des conditions essentielles de leur survie".
Le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale, décrit une impasse. "On parle d'une violence systématique, organisée, pour laquelle les militaires français n'étaient pas préparés et avec sur place des acteurs qui vont chercher à instrumentaliser la situation", dit-il à l'AFP.
"Les soldats français ont enterré plus de 50.000 corps au bulldozer", martèle-t-il. "L'armée n'a pas à rougir (...). On met en accusation ceux qui ont essayé de remplir la mission pour laquelle ils étaient envoyés".
Or, la mission elle-même pose question. Au niveau politique, à Paris, le débat est vif. La clarté du mandat va s'en ressentir.
- "Pas faisable" -
Le colonel Patrice Sartre, peut-on lire dans le rapport, "explique clairement la diversité des tâches et leur lourdeur (...). L'armée a la charge de soigner, de nourrir, d'empêcher les massacres (éventuellement en utilisant des armes et au risque d'être critiquée....). Elle doit empêcher les pillages, enquêter sur les vols, les meurtres, ce qui n'est pas faisable".
Et l'officier de prévenir: "nous sommes dans une situation néocoloniale, on ne va pas tarder à nous le reprocher (... ). Nous finirons par déraper un jour ou l'autre". Plus tard, il dira aussi: "il n'est pas possible de se retrouver seul sur le terrain sans aucun texte de référence permettant de guider son action".
Au fil du rapport transparaît un effectif sur le terrain que personne n'écoute à Paris. La DGSE (services secrets extérieurs) et des officiers alertent régulièrement sur une situation désastreuse. En vain.
"On peut se demander si, finalement, les décideurs français voulaient vraiment entendre une analyse qui venait, au moins en partie, contredire la politique mise en oeuvre", constate le rapport.
L'officier de l'armée de terre décrit lui aussi une forme de déni, qui a figé le politique avant d'accabler le militaire. Les décideurs autour du président de la République "ont fait une erreur manifeste, colossale et criminelle de jugement, d'évaluation. Et ils se sont enfermés dans leur interprétation des choses", assure-t-il.
"C'est terrible à dire, mais le réel n'a pas été assez fort pour qu'ils se disent: +on est en train de faire une énorme erreur+".
bur-dla/fz/pid/hba


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
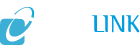
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)