Présentes depuis des années, elles assurent l'urgence humanitaire ou font du développement, dans des conditions de plus en plus périlleuses. Pourtant, le travail des ONG au Sahel passe souvent au second plan d'une approche essentiellement sécuritaire.
Avant d'être une région de conflits, de groupes armés et d'opération antijihadiste, le Sahel est une des zones les plus pauvres du monde, où près de la moitié de la population vit avec moins d'1,25 dollar par jour, et où les pays ont les indices de développement les plus bas.
Des centaines d'ONG internationales et locales y travaillent depuis longtemps, revendiquant une connaissance fine du terrain et des enjeux locaux.
Mais depuis l'explosion du conflit malien en 2012 et la propagation des violences dans les pays voisins, les projecteurs restent essentiellement braqués sur les opérations des militaires français de Barkhane et des armées régionales.
Pourtant, "les ONG ont leur mot à dire", insiste Frédéric de Saint-Sernin, directeur général délégué d'Acted, endeuillée par le meurtre en août de six de ses jeunes humanitaires français, tués par des hommes à moto au Niger.
"Nous mettons en place des programmes très difficiles dans des zones où personne n'est présent, 90% de notre personnel est local... et on ne nous demande pas notre vision des choses. On prend l'avis des militaires, des diplomates, des policiers, mais pas celui des humanitaires", déplore-t-il, alors que s'ouvre lundi à N'Djamena un sommet du G5 Sahel (Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) et la France pour faire le point sur la situation sécuritaire et politique.
- Conditions dégradées -
Attaques jihadistes, tensions communautaires, lutte pour les ressources, absence de l'Etat: les ONG travaillent dans des conditions de plus en plus dégradées.
"En dehors des grandes villes tenues par les gouvernements, la situation dans les campagnes est extrêmement complexe. Ce sont des zones grises, qui ne sont pas à proprement parler administrées par les insurgés", et où la situation est extrêmement mouvante, explique Pierre Mendiharat, directeur adjoint des opérations de Médecins sans Frontières (MSF).
"On est obligé en permanence de négocier notre présence", poursuit-il, décrivant "un travail de réseautage difficile, car il y a des changements permanents de contrôle territorial".
La difficulté, pour les ONG, est de trouver un espace entre les myriades de groupes - jihadistes, mais aussi milices "d'autodéfense" et forces gouvernementales régulièrement accusées d'exactions - qui se disputent les territoires. Et de composer avec pressions de gouvernements qui les accusent parfois de "complicité" avec certains groupes armés.
"La sécurité de nos équipes se fonde sur l'intérêt que les belligérants voient à notre présence", résume M. Mendiharat. "Les principes de neutralité et d'impartialité, les belligérants s'en foutent".
L'exacerbation des tensions communautaires, notamment au Mali, préoccupe particulièrement MSF, qui a recensé en 2020 cinq ou six intrusions dans ses centres de santé - "des hommes armés venus chercher des blessés qu'on ne revoit jamais" - et, tout récemment, le blocage d'une de ses ambulances dans le centre du pays, provoquant la mort d'un blessé.
Les ONG sont elles-mêmes visées. Du simple vol de matériel aux attaques et aux enlèvements, voire aux meurtres, le spectre des "incidents" est large.
Rien qu'en 2020, l'ONG INSO, dédiée à la sécurité humanitaire, a recensé 54 "incidents" au Burkina Faso, dont deux mortels et une trentaine d'enlèvements. Ils touchent en grande majorité le personnel local, le seul à pouvoir encore se déployer hors des capitales.
"Malheureusement, ce sont les populations qui subissent les conséquences de ces attaques. L'aide et les soins sont considérablement retardés, voire suspendus", déplore Mirella Hodeib, une responsable du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Mali, dont deux véhicules ont été attaqués en septembre.
- Réussites fragiles-
Dans ce contexte, les ONG enregistrent de "petites victoires", comme l'accès à une ville coupée du monde pendant des semaines, ou la possibilité de soigner sans entrave plusieurs jours d'affilée.
Et malgré l'insécurité et des processus bureaucratiques souvent très lourds, des projets de développement continuent. L'Alliance Sahel, plateforme de 13 pays et bailleurs, a lancé depuis 2017 plus de 800 projets, et met en avant des résultats concrets: plus de 3 millions d'enfants vaccinés, accès à l'électricité pour 550.000 personnes, à l'eau potable pour 5,6 millions.
"Il y a cinq ans il n'y avait quasiment aucun bailleur au Sahel. Aujourd'hui à Bamako, Ouagadougou ou Niamey, il y a un fort tissu institutionnel, notamment grâce aux banques de développement", se félicite Jean-Bertrand Mothes, de l'AFD (Agence française de développement), qui, en partenariat avec les ONG locales, intervient prioritairement dans les zones les plus vulnérables.
Mais pour de nombreux observateurs, ces succès ne resteront qu'une goutte d'eau sans le retour des Etats dans les territoires et la restauration de la confiance avec les populations.
cf-ah/fz/sst/mlb


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
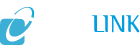
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)