Près de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le souvenir de la colonisation reste vivace chez une partie de la jeunesse française d'origine algérienne, alors qu'un rapport remis mercredi à Emmanuel Macron prône la réconciliation des mémoires des deux pays.
"C'est fou qu'en 2021, on parle encore de ça et qu'on soit encore en train d'essayer de faire ce qui aurait dû être fait il y a quarante ans". Pour Leïla Boukerroui, 35 ans et fille de Harki aujourd'hui installée en Gironde, le travail de mémoire sur la guerre d'Algérie n'a que trop tardé.
En commandant son rapport à l'historien Benjamin Stora, Emmanuel Macron expliquait lui-même en décembre vouloir "finir le travail historique sur la guerre d'Algérie", ajoutant que les mémoires liées à ce conflit "sont autant de blessures".
Pour la psychanalyste Karima Lazali, autrice de "Trauma colonial, enquête sur les effets psychiques et politique de l'oppression coloniale en Algérie" (Ed. La Découverte), "la blessure est uniquement envisagée chez l'autre qui a été colonisé, mais jamais au sein de sa propre population et ça, ça fait beaucoup de dégâts chez les descendants de l'immigration".
- "Décoloniser les mentalités" -Des dégâts, mais aussi beaucoup de questions chez une génération qui ne bénéficie pas toujours des récits de ses grands-parents qui ont connu la violence de la guerre, mais restent souvent emmurés dans le silence.
Pour Dounia Ouahid, 24 ans, dont les grands-parents maternels sont algériens, le passage à l'âge adulte amène à s'interroger sur cette mémoire enfouie. "Comme j'ai mûri, forcément je me pose des questions sur ce qui s'est passé et j'ai envie d'en savoir plus sur mon histoire: ça en fait partie même si je ne l'ai pas vécu."
Elle aussi confie que ses grands-parents restent mutiques sur le sujet, eux qui ont fini par s'installer à Clermont-Ferrand après la guerre pour décrocher un emploi chez Michelin. "Du côté de ma mère, on n'en parle pas. Bizarrement, c'est mon père, qui est marocain, qui pose des questions."
L'enjeu est double pour Karima Lazali: si briser le silence est indispensable, il faut aussi "décoloniser les mentalités" dans un pays qui compterait, selon le rapport Stora, deux millions de personnes algériennes ou d'origine algérienne.
Rejetées par l'exécutif, des excuses de l'Etat français seraient toutefois indispensables selon Mohand Bencherif, un chef d'entreprise de 32 ans, dont le père a combattu l'armée française avant de quitter l'Algérie en 1963, face à une "révolution confisquée" par le pouvoir.
"Les gens ne demandent pas de réparation, juste une reconnaissance de l'Histoire", souligne ce Franco-algérien né en Seine-Saint-Denis. "On ne demande pas de justifications, juste des excuses, et on passe à autre chose. La France doit s'excuser de ne pas avoir été à la hauteur des valeurs françaises."
Le trentenaire compare la réconciliation franco-allemande, qui n'a duré qu'"une grosse dizaine d'années", à celle encore en cours entre ses deux pays. "On en est encore loin", déplore-t-il.
"Les Français d'origine algérienne sont forcément impactés par ce qui reste actuel de cette histoire, interrogeant leur place dans la République puisque dès qu'il est question d'intégration, de voile, on revient sur les mêmes mots que ceux employés pendant l'époque coloniale", explique la psychalanyste.
- Processus laborieux -Chez Leïla Boukerroui, dont le père est arrivé au camp de Bergerac (Dordogne) en juin 1962 parmi les quelque 60.000 harkis amenés en France, la rancoeur est moins présente. "Mon père a vraiment voulu nous tenir éloignés de ça, il ne nous l'a pas fait ressentir. C'est en grandissant que je me suis dit que ce qui leur était arrivé n'était pas juste."
Dans cette optique de réconciliation, le rapport de Benjamin Stora préconise des actes symboliques forts, sur le partage des archives de la période coloniale ou la question des personnes disparues durant la guerre.
Un processus qui se fait laborieusement depuis la fin du conflit en 1962, la France n'ayant qualifié cette période de "guerre" qu'en 1999. Il ne pourra être mené à bien que s'il "associe tous les protagonistes" selon Karima Lazali, qui ajoute: "On ne sort pas de 130 ans d'histoire terrible par un +happy end+".
fby/jt/dch
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
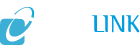
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)