A peine évacuée de Kaboul vers Paris, à l'été 2021, Farzana Farazo promettait de poursuivre le combat féministe en exil. Un an plus tard, elle est "déprimée": pour elle comme pour les autres militantes réfugiées, les espoirs se sont vite heurtés à une intégration semée d'embûches.
L'ancienne policière, rencontrée à nouveau par l'AFP douze mois après la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021, confie ne pas avoir dormi pendant des mois.
Exfiltrée en priorité par la France en raison de son militantisme, cette membre de la minorité hazara persécutée par les talibans vit toujours chez une hébergeuse associative, en banlieue parisienne.
"Franchement, je n'ai rien fait de spécial", avoue la jeune femme de 29 ans. "D'abord, je ne parle pas assez français, et on a une différence de conception de l'action militante. Ici, on parle beaucoup."
Depuis un an, elle passe de cours de français en rendez-vous avec une assistante sociale et attend de se voir attribuer un logement: "J'ai rencontré beaucoup de difficultés", dit-elle pudiquement.
"Quand tu ne te sens pas bien, c'est difficile de te concentrer. Comme beaucoup d'autres, j'étais indépendante en Afghanistan, j'avais un emploi, je suis éduquée. Donc se retrouver démunie en France, c'est difficile et ça nous plonge dans la dépression."
A tel point que de nombreuses camarades de lutte rencontrées à l'été 2021 ont refusé une nouvelle rencontre, évoquant pour beaucoup la "honte" de n'avoir rien accompli de concret.
- Tour Eiffel -Ces réfugiés sont "engagés dans le processus d'intégration", mais il "reste très insuffisant" en particulier sur le plan de la langue, estime Didier Leschi, patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'organisme public chargé d'organiser l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés.
"Mais elles sont plus aidées que le reste des Afghans, qui ne peuvent compter que sur l'Etat, car elles ont des réseaux culturels, professionnels en place", nuance-t-il.
Mursal Sayas, journaliste et militante féministe, dit avoir eu "de la chance dans (son) malheur", en recevant dans son appartement avec vue imprenable sur la tour Eiffel. Le logement lui a été mis à disposition par une éditrice qui lui a commandé un livre sur la condition féminine en Afghanistan.
"On a tout perdu, notre pays, notre liberté, nos accomplissements. On a été soudain propulsées dans un pays avec tout à refaire. Mais la France est devenue notre maison au moment où notre pays s'est enfoncé dans l'obscurité. Alors même si c'est dur, c'est notre responsabilité de continuer à militer, parce qu'on peut parler, on a la liberté d'expression que les filles en Afghanistan n'ont plus. On doit dénoncer les injustices, les inégalités, l'apartheid contre les femmes", développe-t-elle, carré brun bouclé et mains manucurées.
Lors des premiers mois après l'arrivée des talibans, des femmes ont organisé des manifestations en Afghanistan. Mais ces rassemblements ont quasiment cessé, après que plusieurs de ces manifestantes ont été arrêtées et sévèrement battues en prison, selon des témoignages rapportés par Amnesty International.
Les Afghanes qui ont fui le pays parce que leur vie était en danger "sont une source d'énergie positive pour nous", déclare à l'AFP, à Kaboul, une femme qui avait participé aux manifestations dans la capitale. "Nous savons qu'elles n'oublient pas les femmes d'Afghanistan".
- Déclassement -A Paris, une petite musique a plongé Mursal Sayas dans un profond malaise, qu'elle a décrit dans un article pour Courrier international, posé sur sa table basse avec le dernier numéro de Paris Match consacré au "martyre" des femmes afghanes. Elle vivait alors en centre d'hébergement et "l'Afghanistan avait disparu des médias". "On entendait dire qu'il fallait plutôt accueillir les Ukrainiens, parce qu'ils sont +civilisés+ et qu'ils ont les yeux bleus. C'était dégoûtant."
En quittant son pays, a-t-elle fait le bon choix ? "Tous les jours, quand je me réveille et que je ne peux pas voir mes proches, ça me fait mal. Mais quand je pense que j'aurais pu être capturée par les talibans et ne plus jamais parler de mes soeurs (afghanes), je trouve que c'est pire", résume-t-elle.
Pour d'autres, un sentiment de déclassement s'est ajouté aux difficultés d'intégration et aux affres du déracinement.
"Je suis en crise identitaire", reconnaît Rada Akbar, une artiste arrivée en France il y a un an. "Et ça va me prendre du temps pour gérer ça, je ne peux pas juste devenir une nouvelle personne", relève la dessinatrice de 34 ans, qui veut donner à voir les "pertes invisibles" de la culture afghane lors du conflit avec les talibans.
Elle aussi assure que le combat continue. Mais d'un mot, elle résume ce que sont devenus les espoirs d'août 2021: un "cauchemar".
sha/fmp/ybl


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
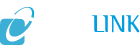
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)