Le Kenya scrutait mercredi les résultats de la présidentielle de la veille qui s'est déroulée dans le calme, émaillée par quelques problèmes techniques, retards de vote ou incidents sécuritaires à la marge.
Mais alors que le dépouillement est en cours, et ne permet pas de dégager de tendance dans le duel serré entre les deux favoris Raila Odinga et William Ruto, les risques d'une énième bataille post-électorale sont élevés.
Il faut remonter à 2002 pour trouver une présidentielle dont les résultats n'ont pas été contestés, et la mémoire du sang coulé lors de ces disputes électorales est encore vive.
- Le comptage -La Commission électorale indépendante (IEBC) a jusqu'au 16 août maximum pour annoncer les résultats. Plus elle prendra de temps, plus le risque de tensions est important, selon des analystes.
Dans cette perspective, "la Commission appelle à la patience", a exhorté à nouveau mercredi Wafula Chebukati, président de l'IEBC.
Il faut en effet à l'IEBC dépouiller plus de 130 millions de bulletins qui ont été déposés dans plus de 46.000 bureaux de vote, puis transmettre et consolider les résultats.
Au total, six scrutins étaient convoqués mardi, les 22,1 millions d'électeurs devant aussi choisir leurs parlementaires, gouverneurs et 1.500 élus locaux.
Les résultats définitifs seront annoncés au centre Bomas, lieu touristique de la capitale transformé temporairement en forteresse hautement surveillée où personne ne peut pénétrer sans accréditation.
Pour l'emporter, un candidat doit recueillir 50% des voix plus un vote, ainsi que 25% des voix dans la moitié des 47 comtés. Si ces conditions ne sont pas remplies, un second tour doit être organisé dans les 30 jours, ce qui n'est jusqu'alors jamais arrivé au Kenya.
- Action en justice -Tout recours en justice doit être déposé auprès de la Cour suprême dans les sept jours après l'annonce des résultats. La plus haute instance judiciaire du pays dispose ensuite de 14 jours pour rendre sa décision, et, en cas d'annulation du scrutin comme en août 2017, une nouvelle élection doit se tenir dans les 60 jours.
Si personne ne saisit la justice, le nouveau président élu prend ses fonctions dans les deux semaines suivant l'annonce des résultats.
Dans le pire des scénario, les bras de fer judiciaires pourraient durer jusqu'à avril ou début mai 2023. Mais ce cas de figure est fortement improbable.
Selon Ben Hunter, de l'institut d'analyse Verisk Maplecroft, le système judiciaire au Kenya est l'un des plus "robustes" de la région.
"Si le résultat est contesté, et qu'un candidat dépose une requête auprès de la Cour suprême, ce serait une étape positive car sinon l'alternative est d'appeler les partisans à protester."
"La Cour jouit d'une forte crédibilité et un processus judiciaire agirait comme une soupape pour les tensions politiques."
L'Union africaine, l'Union européenne et le Commonwealth entre autres ont envoyé des observateurs pour surveiller les élections, aux côtés de milliers de représentants de la société civile.
- Disputes passées -Raila Odinga, 77 ans s'est déjà lancé quatre fois dans la course présidentielle, sans succès: en 1997, 2007, 2013 et 2017, et a affirmé s'être fait voler la victoire lors de ces trois derniers scrutins.
En août 2017, il a saisi la justice criant au piratage du système électoral. La Cour suprême avait, dans une décision inédite en Afrique, ordonné l'annulation du scrutin en raison "d'irrégularités" en grande partie imputée à l'IEBC.
La nouvelle présidentielle s'était tenue en octobre, boycottée par Odinga et remportée par Uhuru Kenyatta.
Des dizaines de personnes étaient mortes dans la répression des manifestations.
Dix ans plus tôt, en 2007, la lenteur et l'opacité du dépouillement de la présidentielle avaient renforcé les soupçons de fraude chez les partisans du candidat Odinga.
L'annonce de la victoire du président sortant Mwai Kibaki avait alors déclenché une violente contestation. Plus d'un millier de personnes avaient été tuées dans des affrontements politico-ethniques sans précédent et plus de 600.000 avaient été déplacées.
txw/amu/al/md/cpy


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
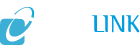
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)