De la lutte contre la vie chère à celle contre la corruption endémique, nombreux sont les défis qui attendent le nouveau président élu du Kenya, William Ruto, pour maintenir le cap de cette dynamique économie d'Afrique de l'Est.
- Pouvoir d'achatLa problématique de la vie chère s'est imposée durant la campagne.
Des centaines de manifestants déjà durement touchés par les retombées économiques du Covid-19 ont menacé début juillet de bouder les urnes le 9 août si les prix de l'essence et des denrées alimentaires ne baissaient pas.
Le gouvernement a évoqué le 20 juillet une subvention pour réduire le prix de la farine de maïs, qui sert à préparer le plat de base dans le pays, l'ugali.
Mais la promesse est restée lettre morte. Ces coups de pouce sont de plus temporaires, "populistes" et "simplistes" au moment où l'inflation grimpe à des niveaux inédits depuis cinq ans pour atteindre 8,3% en juillet, selon Jared Osoro, économiste à l'université de Nairobi.
Les impacts du conflit en Ukraine sont venus assombrir les perspectives de reprise économique.
De 7,5% en 2021, la croissance devrait s'établir à 5,5% en 2022, selon la Banque mondiale qui prévoit par ailleurs une détérioration de la balance commerciale cette année. Le Kenya importe habituellement un cinquième de ses céréales de Russie et 10% d'Ukraine, selon les chiffres officiels.
L'agriculture (plus de 22% du PIB) pâtit aussi de l'envol des prix des engrais et se voit par ailleurs menacée par la sécheresse.
- Dette D'ici 2050, la moitié de la population vivra en ville, ce qui entraînera "une myriade de défis" dont l'éducation et l'accès à la santé, note Oxfam. Selon l'ONG, 34% des 17 millions de personnes pauvres au Kenya vivent dans des zones urbaines, pour la plupart dans des logements informels.
Pour accompagner le développement du pays, les gouvernements successifs depuis 2008 poursuivent l'ambitieux programme Vision2030, principalement axé sur les grands projets d'infrastructures.
Conséquence: sous l'ère Uhuru Kenyatta (2013-2022), la dette a plus que quadruplé pour avoisiner 70 milliards de dollars.
La Chine est désormais le deuxième bailleur du Kenya, derrière la Banque mondiale. Pékin a notamment prêté 5 milliards de dollars pour l'emblématique ligne de train reliant Nairobi au port de Mombasa.
Le Fonds monétaire international, qui a prêté l'année dernière 2,34 milliards de dollars au Kenya, a salué en juillet la poursuite du rebond économique et l'augmentation des recettes fiscales.
Mais "le Kenya reste exposé à des risques élevés de surendettement, et c'est pour cela qu'il est important qu'il reste fermement sur la trajectoire fixée pour réduire la vulnérabilité de la dette", commente Mary Goodman, cheffe de la mission du FMI.
- Corruption Le bilan en la matière a "stagné", selon l'ONG Transparency International qui plaçait le pays 128e sur 180 dans son dernier index mondial de perception de la corruption.
Sous la pression internationale, de bailleurs et d'investisseurs en particulier, il y a eu un "renforcement des institutions de contrôle", une médiatisation du phénomène incrusté dans toutes les strates de la société et "un assainissement du milieu des affaires", énumère Alexia Van Rij, spécialiste en évaluation des politiques publiques du développement.
La justice s'est par ailleurs penchée sur quelques affaires troubles, dont l'enrichissement du nouveau vice-président élu, Rigathi Gachagua.
Si des dizaines de hauts responsables ont été inculpés depuis 2018, dont l'ex-ministre des Finances Henry Rotich, "aucun gros poisson n'a été pris", relève Alexia Van Rij.
- Les jeunes, "bombe à retardement" Avec les trois-quarts de la population âgés de moins de 34 ans, la jeunesse est un des atouts du Kenya, mais son insertion dans l'emploi reste un défi.
Ils sont environ 500.000 chaque année à décrocher un diplôme dans le supérieur. Mais la corruption, le népotisme ou l'exigence d'expérience constituent autant d'obstacles à leur entrée dans la vie active.
Selon des chiffres officiels publiés en 2020, 5 millions de jeunes étaient sans emploi.
La jeunesse est une "bombe à retardement démographique, sociale et économique", estime Alex Awiti, chercheur kényan en politique publique.
Une des pistes est selon lui de "créer des emplois à une échelle industrielle" avec des incitations financières, notamment pour développer le secteur privé dans un pays où 80% de la main d'oeuvre se trouve dans l'économie informelle.
Il faut aussi, selon lui, développer l'agriculture et "renforcer les compétences dans le secteur industriel et les opportunités dans le secteur manufacturier".
- UnitéFait inédit depuis 2002, le nouveau président élu n'est pas issu de l'influente ethnie kikuyu au solide réseau économique.
William Ruto est kalenjin, comme l'ancien président Daniel arap Moi (1978-2002). Il devra donc bâtir un nouvel équilibre politico-ethnique dans un pays aux 46 ethnies, où l'appartenance communautaire, instrumentalisée depuis les Britanniques, est un pion essentiel de l'échiquier politique.
al/md/jhd


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
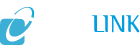
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)