La reconnaissance par Emmanuel Macron de la torture et de l'assassinat en 1957 du dirigeant nationaliste Ali Boumendjel par l'armée française est un geste visant à apaiser les plaies encore vives de la guerre d'Algérie.
- Huit ans d'un sanglant conflit -Dans une Algérie colonisée par la France depuis 1830 et dont les revendications ont été réprimées dans le sang en 1945, une soixantaine d'attentats simultanés, signés par un FLN (Front de libération nationale) jusqu'ici inconnu, créent la stupeur à la Toussaint 1954.
Commence alors un conflit qui fit près de 500.000 morts civils et militaires, dont quelque 400.000 Algériens, selon les historiens.
Pendant huit ans, la répression implacable de l'armée française répond aux massacres et aux attentats du FLN, qui élimine aussi ses concurrents nationalistes.
- La bataille d'Alger et la torture -Début 1957, des bombes posées par le FLN explosent dans des cafés et stades d'Alger, faisant 15 morts et des dizaines de blessés. Le général Jacques Massu se lance alors dans un combat sans merci contre le FLN. Jusqu'en octobre 1957, des milliers de suspects sont emprisonnés et torturés, beaucoup éliminés.
Dès 1958, une des victimes de ces tortures, le communiste Henri Alleg, livre son témoignage dans un livre choc, aussitôt interdit, "La Question".
Plus de quatre décennies plus tard, le général Paul Aussaresses avoue avoir pratiqué la torture et admet notamment avoir ordonné à l'un de ses subordonnés de tuer Ali Boumendjel. La militante du FLN Louisette Ighilahrizen raconte avoir été torturée et violée.
- Indépendance, rapatriés et harkis -En mai 1958, sous la pression des militaires et des colons français en Algérie, le général de Gaulle revient au pouvoir. Après avoir maté en 1961 une tentative de coup d'Etat des généraux, il négocie avec le FLN.
Le 19 mars 1962, les accords d'Evian proclament un cessez-le-feu immédiat et ouvrent la voie en juillet à l'indépendance de l'Algérie.
Dans une période de chaos, les partisans de l'Algérie française de l'OAS (Organisation de l'armée secrète) fomentent à leur tour des attentats. Les colons s'enfuient : près d'un million de "rapatriés" arrivent en France.
Quelque 60.000 harkis, auxiliaires algériens de l'armée française, les accompagnent. Mais 55.000 à 75.000 sont abandonnés à leur sort par la France en Algérie et, pour la plupart, massacrés.
- Introspection douloureuse -La France ne qualifie officiellement cette période de guerre qu'en 1999.
Comme Valéry Giscard d'Estaing, premier chef d'Etat français à avoir effectué en 1975 une visite officielle dans l'Algérie indépendante, François Mitterrand et Jacques Chirac se gardent de condamner la colonisation.
En 2007, à Alger, Nicolas Sarkozy déclare que "le système colonial a été profondément injuste" mais souligne qu'"à l'intérieur de ce système, il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui ont aimé l'Algérie, avant de devoir la quitter". Il évoque "d'innombrables victimes des deux côtés".
En 2012, François Hollande, à Alger, déclare que "pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal". Le 19 mars 2016, il est le premier président à commémorer la fin de la guerre d'Algérie, provoquant une levée de boucliers.
- Des "actes symboliques" -En septembre 2018, le président Emmanuel Macron reconnaît que le jeune mathématicien communiste Maurice Audin est mort sous la torture de l'armée française en 1957, et demande "pardon" à sa veuve.
En octobre 2020, aux Mureaux (région parisienne), il estime que le "séparatisme" islamiste est en partie "nourri" par ce pan de l'Histoire.
Après la publication du rapport de l'historien français Benjamin Stora, en janvier 2021, M. Macron s'engage à prendre des "actes symboliques" pour tenter de réconcilier les deux pays, mais exclut toute "repentance" et "excuses".
Le 3 mars 2021, il reconnait, "au nom de la France", que l'avocat et dirigeant nationaliste algérien Ali Boumendjel a été "torturé et assassiné" le 23 mars 1957 par l'armée française, contredisant la version initiale d'un suicide.
vdr-jba/cds/vk


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
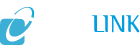
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)