Réda Kriket et la "cellule d'Argenteuil", soupçonnés d'avoir projeté un attentat en 2016, étaient-ils "téléguidés" depuis la Syrie par le groupe Etat islamique? La cour d'assises spéciale de Paris s'est confrontée mercredi aux nombreuses "hypothèses", sans "certitudes", de l'enquête.
Le 24 mars 2016, deux jours après les attentats de Bruxelles, et quelques mois après ceux du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, un arsenal de grande ampleur était découvert dans un appartement d'Argenteuil (Val-d'Oise), loué depuis l'été par Réda Kriket : fusils d'assaut, armes de poing, munitions et substances explosives artisanales en nombre "inédit".
Les services antiterroristes en sont persuadés: une "tuerie de masse" a été évitée avec le démantèlement de la "cellule d'Argenteuil". Mais quelle était sa cible et qui étaient ses commanditaires?
"C'est un projet d'attaque piloté depuis la Syrie", assure, fermement, une enquêtrice de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), témoignant anonymement par visioconférence.
Pendant un exposé de trois heures, elle ramène la cour à "la racine" du terrorisme islamiste, dans les années 1990. Algérie, Bosnie, Afghanistan, Tchétchénie... Dans son box, l'un des principaux accusés, Réda Kriket, masque glissé sous le nez, s'agace de cette leçon de "géopolitique".
Après une suspension, il refuse ostensiblement, et comme il est d'usage, de se lever à l'arrivée de la cour : ce n'est "pas dans (sa) tradition". "C'est une question d'éducation", rétorque, cinglant, le président Laurent Raviot.
L'ancien braqueur de 39 ans, condamné en son absence en juillet 2015 en Belgique pour terrorisme, a toujours contesté tout projet d'attentat et tout séjour en Syrie.
Pour l'enquêtrice de la DGSI, plusieurs "éléments" convergent vers un tel passage en Syrie de Réda Kriket, en compagnie d'Anis Bahri, l'un de ses six coaccusés. Une "présence commune" des deux hommes en janvier 2015 en Turquie à une époque où la frontière est "extrêmement poreuse". Un "silence radio" auprès de leurs familles respectives et des téléphones éteints pour "éviter toute géolocalisation". Des faux papiers et une grande discrétion, détaille encore le témoin.
- "Marge de manoeuvre" -"Ce séjour en Syrie, vous avez une certitude là-dessus ou c'est de l'ordre de l'hypothèse?", veut savoir le président.
C'est "hautement probable", répond l'enquêtrice, qui convient: "Après, je n'ai pas de preuves".
Pendant l'enquête, Anis Bahri avait aussi contesté ce voyage en Syrie, mais confirmé avoir bien tenté de s'y rendre en octobre 2015. L'accusé de 37 ans, qui a finalement pris place dans le box après avoir refusé de comparaître lundi et mardi, n'avait pas non plus caché au juge d'instruction sa sympathie pour l'EI.
Les messages qu'il a échangés sur l'application Telegram le 26 mars 2016, la veille de son arrestation à Rotterdam, aux Pays-Bas, et deux jours après "l'interpellation médiatisée" de Réda Kriket en région parisienne, interrogent particulièrement. Anis Bahri demande alors à un interlocuteur basé en Syrie d'y être exfiltré.
Et se prévaut pour cela de deux "garants", Boubakeur El Hakim et Abdelnasser Benyoucef, deux cadres de l'EI en charge des "opérations extérieures". L'ombre du premier plane sur les attentats de janvier 2015 et sur ceux du 13-Novembre, le second est accusé d'avoir "activé" Sid-Ahmed Ghlam pour l'attentat de Villejuif en avril de la même année.
"Il y a peu de dossiers" avec cette double référence, souligne l'enquêtrice de la DGSI. "C'est pour nous une marque de ce lien intrinsèque entre la cellule d'Argenteuil et les opérations extérieures" de l'EI, appuie-t-elle.
Pourquoi parler "quand même" d'un lien avec la Syrie, alors qu'"aucun message opérationnel relatif à un projet d'attentat" n'a été retrouvé dans ce dossier, contrairement à d'autres, lui demande l'une des avocates générales.
Il n'y a "pas d'incohérence", estime l'enquêtrice. "L'EI, dans son fonctionnement, laisse une grande marge de manoeuvre aux opérationnels sur telle ou telle cible".
Des affirmations qui font bondir l'avocate d'Anis Bahri, Camille Fonda: "Avez-vous un exemple d'un attentat prétendument commandité par l'Etat islamique, sans qu'aucune information ne soit donnée aux prétendus commanditaires sur la cible, la date, le plan?". La réponse du témoin est évasive et l'avocate de la défense en "(conclut) qu'il n'y a pas d'autre exemple".
Le procès doit durer cinq semaines.
asl/pga/bma


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
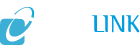
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)