Les mêmes accusations, les mêmes dénégations mais un verdict contraire: la condamnation mercredi en appel de l'ex-secrétaire d'État Georges Tron pour viol et agressions sexuelles deux ans après son acquittement a créé la surprise, au terme d'un procès qui a basculé sur la question du consentement.
Depuis 2011, le maire de la commune de Draveil (Essonne) est accusé par deux de ses anciennes employées d'avoir profité de séances de réflexologie plantaire, dont il est un adepte, pour leur imposer attouchements et pénétrations digitales, généralement avec son adjointe à la Culture d'alors, Brigitte Gruel.
En 2018, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis les avait acquittés en jugeant que les deux femmes n'avaient pas été soumises par M. Tron à une quelconque forme de contrainte, indispensable pour caractériser un viol ou une agression sexuelle.
Au terme de onze heures de délibéré, la cour d'assises de Paris a estimé à l'inverse mercredi soir que le maire avait exercé sur une des plaignantes, Virginie Ettel, une "contrainte morale" caractéristique d'une "absence de consentement", du fait de sa personnalité et de sa supériorité hiérarchique.
En conséquence, elle a infligé au sexagénaire cinq ans de prison, dont trois ferme.
Le même jury l'a en revanche acquitté de faits de viol et d'agression sexuelle sur l'autre plaignante, Eva Loubrieu, en arguant des "déclarations imprécises" et "variables dans le temps" de l'intéressée.
- "Décision majeure" -À l'heure où les dénonciations spectaculaires n'en finissent pas de nourrir le débat sur les violences sexuelles et les rapports de pouvoir entre hommes et femmes, la question du consentement a largement animé les quatre longues semaines d'audience du procès en appel de Georges Tron.
Les parties civiles ont puisé dans cet air du temps pour plaider la cause des accusatrices, quand la défense a tenté d'éviter que le maire n'en devienne un emblème.
"Sur le plan judiciaire, sociétal, c'est une décision majeure. Elle aura un retentissement au-delà du dossier", s'est réjoui auprès de l'AFP Me Loïc Guérin, l'avocat d'Eva Loubrieu, après la condamnation de M. Tron. "Il y a vingt ans, on n'aurait sans doute jamais eu un procès comme celui-là".
Le maire "a le droit de ne pas être le symbole d'un autre procès que le sien", avait plaidé pour sa part son avocat, Me Antoine Vey.
Faute de preuves matérielles suffisantes, les débats ont viré à l'affrontement "parole contre parole" entre les récits des plaignantes et les dénégations des deux accusés. Et ont confronté la cour à des questions épineuses.
Si l'on considère que les scènes sexuelles décrites par les plaignantes ont bien eu lieu, les deux employées municipales étaient-elles ou non consentantes sur le moment ? Un consentement a-t-il pu se transformer a posteriori en non-consentement ? Les deux femmes n'ayant pas affiché de résistance, se sont-elles senties contraintes par l'autorité du maire ?
- Contradictions -En première instance, le jury avait jugé crédible l'existence de relations sexuelles en raison du "climat général hyper-sexualisé" qui régnait à la mairie de Draveil. Mais il avait écarté toute contrainte en pointant certaines contradictions, et même mensonges, des plaignantes.
En appel, l'accusation et les parties civiles ont soutenu que Georges Tron, décrit comme un roitelet au sein de sa mairie, avait exercé sur elles une "emprise", un ascendant moral constitutif selon eux d'une contrainte.
La cour leur a en grande partie donné raison dans le cas de Virginie Ettel, dont elle a relevé les "déclarations constantes et circonstanciées", mais pas dans celui d'Eva Loubrieu.
Lors de son interrogatoire à la barre, cette dernière a d'abord affirmé avoir toujours refusé les propositions de l'édile, avant de se contredire quelques minutes plus tard en indiquant avoir espéré, un temps, une relation avec lui.
La défense de Georges Tron a ainsi brandi au procès des textos au ton affectueux envoyés à la période des faits par Eva Loubrieu à l'élu. "En mai 2007, elle commence à être violée, elle ne veut plus de relation, mais surtout elle dit à son violeur +pensez à moi+ ?", s'était étonnée Me Solange Doumic.
Dans sa plaidoirie lundi soir, une avocate de Virginie Ettel, Me Laure Heinich, avait demandé à la cour qu'elle défende dans sa décision "le droit de coucher avec son patron" ou "de faire des plans à trois". Mais, avait-elle aussitôt ajouté, à condition que "le consentement, on le réassure".
amd/fan/pa/pb


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
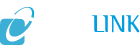
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)