"On se remet en question chaque jour": dans un quartier sensible de Compiègne (Oise), la police multiplie les interventions pour déséquilibrer le trafic de drogue, mais le débat national sur les violences policières et l'intensification des tensions pèsent sur certaines pratiques.
En arrivant au Clos des Roses en début de soirée, la patrouille de police est accueillie par une nuée de flashs. "Tu vas rien faire, on filme tout!", lance l'un des jeunes réunis devant un barbecue à l'entrée d'un HLM, en pointant son téléphone portable sur les agents.
"Ils n'ont plus peur: ils viennent carrément au contact en criant et en filmant", souffle un fonctionnaire, LBD en bandoulière, qui tient à garder l'anonymat.
Depuis septembre 2020, la police nationale multiplie les interventions dans ce quartier sud de Compiègne pour assécher la demi-douzaine de points de vente de stupéfiants - cocaïne, cannabis, héroïne - qui a valu aux lieux le surnom de "cité du crack".
Mais ces derniers mois, les polémiques ont enflé sur les violences policières, sur fond de contestation de la loi sécurité globale et d'accusations de racisme, tandis que le "Beauvau de la Sécurité" doit poser les bases des futures réformes.
"La façon dont on peut être regardés influe sur notre travail et on est très précautionneux de la déontologie", assure à l'AFP Pierryck Boulet, qui pilote les activités des 130 salariés du commissariat.
- "Ça va crescendo" -"On est formés pour maitriser nos réponses. Mais avec les réseaux sociaux, il y a la volonté de saisir une image choc de quelques secondes" qui "ajoute une pression", relève un agent, confiant parfois "hésiter" à répondre pour "ne pas prendre de risque".
Tout en scrutant le sol à la recherche de sachets de cannabis, plusieurs agents mettent en avant la "tension permanente" à laquelle ils sont soumis, a fortiori depuis la crise sanitaire.
"Ça peut partir en live en une fraction de seconde. Sur un simple coup de sifflet, on peut se faire encercler", glisse une membre de la patrouille, policière depuis 21 ans, disant constater une "intensification de la violence".
"Ça va crescendo. Les insultes, provocations, c'est quotidien, on n'y prête même plus attention. Ils cherchent à nous pousser à l'erreur", estime-t-elle.
En février, les caméras de vidéosurveillance installées par la municipalité ont été détruites à l'arme à feu "en quelques heures". Mais un autre phénomène inquiète particulièrement les forces de l'ordre: les tirs aux mortiers d'artifice, auxquels elles répliquent par du gaz lacrymogène et des grenades de désencerclement.
"C'est un marqueur d'une situation qui s'est crispée et qui interroge sur le respect des autorités", affirme le commissaire Boulet dans son bureau où sont stockés une quarantaine de tubes saisis lors des opérations.
- "Pas des machines" -Oscillant entre fatigue et résignation, certains reconnaissent des "violences illégitimes" ailleurs en France mais regrettent d'y être associés.
"On a parfois des remarques sur le travail de certains policiers qui ne ressemble pas à ce qu'on fait ici à Compiègne", concède M. Boulet. "C'est parfois pesant."
S'ils ont eu "mal au coeur" devant certaines vidéos, d'autres se disent amers face à un traitement médiatique qu'ils jugent stigmatisant, regrettant qu'on passe "sous silence la sécurité du quotidien, l'assistance aux victimes de vol ou de violences conjugales", explique un capitaine de 29 ans.
Pour autant, la vigilance passe par l'auto-contrôle. Avant chaque opération au Clos des Roses, le commissaire réunit les chefs de groupes devant une carte du quartier pour un "briefing" sur les manoeuvres à tenir. Et les échanges se poursuivent à l'issue des interventions.
"Ça passe par des mini-débriefings, où on dit: +moi j'aurais peut être plutôt fait comme ça+. On se remet en question tous les jours", affirme la policière.
"On n'a pas le choix, on travaille avec de l'humain, pas avec des machines. Un flic qui vous dit qu'il ne le fait pas n'est pas un bon policier."
cmk/rl/pb


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
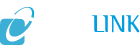
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)