Edouard Balladur, jugé à partir de mardi dans le volet financier de l'affaire Karachi, restera comme le mesuré Premier ministre de Jacques Chirac, son "ami de trente ans", aux ambitions nationales brisées après son échec à la présidentielle de 1995.
A 91 ans, cet homme politique posé mais ambitieux devra répondre de soupçons de financement occulte de cette campagne devant la Cour de justice de la République, qui estime qu'entre six et 10 millions de francs (entre un et 1,5 million d'euros) ont atterri à l'époque sur ses comptes de campagne.
Tour à tour décrit comme un grand bourgeois plein de morgue ou comme un "honnête homme" au style un peu désuet, Edouard Balladur fait irruption dans la vie politique française en 1986 lorsque Jacques Chirac, alors dirigeant d'une droite victorieuse aux législatives, en fait son tout puissant ministre d'Etat chargé de l'Economie, des Finances et des Privatisations dans le premier gouvernement de cohabitation.
Sous les ors du Palais du Louvre, où sont installés à l'époque les locaux de son ministère, le nouveau numéro 2 du gouvernement fait les délices des caricaturistes qui le représentent avec une perruque Louis XV sur une chaise à porteurs.
D'une apparence tranquille et sûre, fidèle au costume à double poches et aux chaussettes rouges, allure plutôt "british" alliée à un langage châtié, M. Balladur est unanimement jugé "courtois". "C'est un peu lassant", commentait ce grand amateur du cérémonial républicain.
Né le 2 mai 1929 à Smyrne (aujourd'hui Izmir) dans une famille de riches marchands levantins catholiques, il quitte la Turquie de Mustapha Kemal avec ses deux frères aînés, son père, directeur de la Banque ottomane, et sa mère, "une femme remarquable" selon lui. La famille débarque à Marseille où il grandit en élève raisonnable et appliqué. Après des études de droit interrompues par une tuberculose, il sort de l'ENA comme auditeur au Conseil d'Etat.
En 1957, il épouse Marie-Josèphe Delacour avec laquelle il aura quatre enfants.
Entré à 35 ans au cabinet de Georges Pompidou alors Premier ministre du général de Gaulle, il participe en 1968 aux côtés de Jacques Chirac aux accords de Grenelle.
Il suit ensuite son mentor à l'Elysée comme secrétaire général adjoint puis secrétaire général de la présidence. C'est dans le privé que Jacques Chirac, devenu président du RPR, vient le chercher pour le ramener à la politique dans les années 80.
En 1988, François Mitterrand est réélu pour son second mandat et la droite perd les législatives. Edouard Balladur tient sa revanche en 1993, avec le retour d'une chambre "bleu horizon" et accède à Matignon.
- Bataille fratricide -A droite, les rôles semblent clairs: à Balladur, le rôle de Premier ministre pour la seconde cohabitation, à Chirac (alors maire de Paris et président du RPR) la préparation de la présidentielle de 1995. Mais le 18 janvier, fort du soutien d'une majorité de l'opinion et du clan Pasqua (dont Nicolas Sarkozy, jeune ministre du Budget), Balladur se déclare candidat à la présidentielle.
Longtemps donné largement en tête du premier tour, le candidat des médias termine finalement derrière Chirac et le socialiste Lionel Jospin.
Son échec sonnera le glas de ses ambitions nationales et cette bataille fratricide entre les deux amis "de trente ans" - l'expression est de Chirac - va durablement diviser la droite entre Chiraquiens et Balladuriens.
Il retrouve son siège de député de Paris et préside à partir de 2002 la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
Fin 2006, il annonce, à 77 ans, son retrait de la vie politique active. En 2010, il décline la proposition de son ancien protégé Nicolas Sarkozy, devenu président, de le nommer au Conseil constitutionnel.
C'est alors qu'il est rattrapé par la justice qui le soupçonne d'avoir alimenté ses comptes de sa campagne grâce à des rétrocommissions sur des contrats d'armement.
En 2017, M. Balladur, qui nie tout financement illicite, est mis en examen par la Cour de justice de la République dans le cadre de "l'affaire Karachi", du nom d'un attentat commis dans cette ville pakistanaise le 8 mai 2002, tuant notamment 11 Français.
bur-rap-cg/jk/ib


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
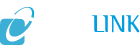
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)