"Climat et résilience": l'intitulé exact du projet de loi attendu lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée reprend le mot très "à la mode" de résilience, terme d'origine anglaise popularisé par la psychiatrie mais présent depuis longtemps chez les écologistes, relève la linguiste Julie Neveux.
C'est la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili qui a "tenu à ce que le mot résilience" figure dans l'intitulé de la loi, souligne son cabinet, interrogé par l'AFP.
Cela montre que "le texte vise à la fois à baisser nos émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter à la réalité du réchauffement climatique", car le "choc climatique" est déjà là, poursuit le ministère.
Dans le projet de loi, le terme vise par exemple le logement et la lutte contre les passoires thermiques, pour qu'il fasse "moins chaud à l'intérieur, quand il faut chaud dehors", et moins froid quand les températures baissent, ajoute le cabinet de Barbara Pompili.
Autre exemple, le développement d'un habitat modulable, qu'on peut déplacer face à l'érosion côtière et la montée des eaux, selon la même source.
L'utilisation du mot résilience en matière climatique n'est pas nouvelle. La mairie de Paris parle volontiers de sa stratégie de "résilience" avec sa politique "d'îlots de fraîcheur".
"Il y a un effet de mode, c'est devenu un terme de communication, sans doute assez efficace" car "il véhicule de l'optimisme", sourit la linguiste Julie Neveux (Sorbonne Université).
Le français emprunte le mot à l'anglais à partir du XIXe siècle, au sens littéral de "fait de rebondir", du latin resilire, indique-t-elle à l'AFP.
Il "signifie d'abord une propriété physique, celle d'un corps (métal, sol, matelas) capable de reprendre sa forme initiale après un choc, mais aussi une capacité psychologique à se remettre d'un traumatisme", ajoute cette spécialiste.
L'emploi écologique se développe dès les années 1970 avec l'écologiste canadien Crawford Stanley Holling, pour désigner la capacité d'un écosystème à revenir à l'équilibre, en absorbant les effets d'une perturbation.
Mais c'est dans le sens psychologique qu'il va être popularisé en France, notamment via le neuropsychiatre Boris Cyrulnik dans les années 2000, souligne Julie Neveux.
Son emploi dans le projet "climat et résilience" aujourd'hui "capitalise donc sur sa popularité auprès du grand public et sur la prise de conscience récente du caractère +épuisable+ de nos ressources physiques et morales", poursuit-elle.
Cette linguiste relève enfin que le préfixe "re-", est très présent dans le domaine écologique avec "recycler" ou "ressourcer:" "le préfixe du retour en arrière signale en réalité un progrès et est devenu synonyme d'espoir", conclut Julie Neveux.
adc/reb/ib/cb


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
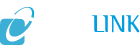
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)