Depuis 2013, l'Uruguay, le Canada et quinze Etats américains ont progressivement légalisé l'usage récréatif du cannabis. Encore récentes, ces expériences ont été suivies d'une hausse modérée de la consommation et d'une réduction du marché noir, avec un impact économique très variable.
- Hausse globale de la consommation -La légalisation n'a pas fait exploser la consommation de cannabis, mais a entraîné partout une hausse modérée de l'usage, à nuancer selon les classes d'âge.
En Amérique du Nord, cette augmentation cache ainsi une différence de comportements entre les adultes, qui reconnaissent utiliser plus de cannabis, et les adolescents dont la consommation semble reculer.
Fin 2020, 20% des Canadiens déclaraient un usage de cannabis dans les trois derniers mois, contre 14% début 2018 avant la légalisation, selon l'agence Statistique Canada. La consommation trimestrielle des 15-17 ans a en revanche reculé, passant de 19,8% à 10,4% lors de l'année suivant la réforme.
Aux Etats-Unis, la plupart des Etats qui ont autorisé son usage enregistrent "un recul de la diffusion du cannabis et des consommations parmi les mineurs", selon une synthèse publiée en janvier par l'Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) sur la base des statistiques officielles américaines. En revanche, la consommation des majeurs a augmenté.
Libéraux, ces Etats ont autorisé des produits alimentaires au cannabis assez puissants, ce qui a causé une hausse des cas d'intoxications. Dans le Colorado, premier Etat à sauter le pas en 2014, les séjours aux urgences liés au cannabis ont augmenté de 60% entre 2012 et 2017, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
Pionnier de la légalisation dès 2013, l'Uruguay a enregistré une augmentation générale de la consommation, y compris chez les mineurs: 14,6% des Uruguayens avouaient leur usage de cannabis en 2018, contre 8,3% en 2011, selon l'Observatoire uruguayen des drogues.
- Marché noir affaibli -Malgré des modalités très différentes, toutes les expériences ont fait reculer le marché noir, sans pour autant le faire disparaître.
La proportion des Canadiens achetant leur cannabis à des dealeurs a fortement baissé, de 51,3% début 2018 à 35,4% fin 2020, selon Statistique Canada.
"C'est un recul assez important et progressif, même s'il faut préciser que certains usagers ont simplement diversifié leurs sources d'approvisionnement et continuent d'avoir recours au marché noir", note Ivana Obradovic, de l'OFDT.
Aux Etats-Unis, l'offre illégale ne répond plus qu'à "30-40% de la demande selon les Etats" qui ont légalisé, selon l'OFDT. Une persistance qui s'explique notamment par la demande des mineurs, exclus des boutiques légales.
Les autorités uruguayennes assurent, elles, avoir divisé par cinq entre 2014 et 2018 le marché noir, auparavant largement dominé par le "prensado", l'herbe illégale venue du Paraguay voisin. Mais seuls 30% des usagers de cannabis annuels sont inscrits dans le registre qui leur permet de se fournir en pharmacie, de cultiver chez eux ou dans un club dédié.
Malgré le prix très bas du cannabis légal, "beaucoup d'usagers continuent de recourir au marché noir, car les entreprises agréées par l'Etat ont peiné à répondre à la demande, il y a eu des ruptures d'approvisionnement, et la limite fixée à 9% de THC - la molécule psychotrope du cannabis, ndlr - est trop faible à leur goût", explique Mme Obradovic.
- "L'or vert", très variable -Les Etats-Unis ont vu émerger un véritable "cannabusiness", qui pesait en 2019 13,6 milliards de dollars et 300.000 emplois à temps plein.
Les recettes fiscales qui en découlent "ne dépassent pas 1% du PIB de chacun des Etats" concernés, note l'OFDT. Elles augmentent toutefois substantiellement chaque année et dépassent pour certains le produit des taxes sur le tabac. En 2020, le Colorado a ainsi récolté 387,5 millions de dollars.
Ces rentrées fiscales financent souvent le budget des Etats au sens large, seuls quelques-uns allouent spécifiquement une partie de ces fonds à la prévention, selon Mme Obradovic. Dans un rapport publié mercredi, les députés français érigent ce modèle en "contre-exemple".
Au Canada, l'industrie légale du cannabis représente 0,4% du PIB, selon Statistique Canada. Plus modeste qu'aux Etats-Unis, le secteur représenterait environ 25.000 emplois directs. La frénésie des industriels s'est heurtée à l'interdiction de la publicité et aux normes strictes de certaines provinces.
Le gouvernement fédéral, qui a perçu l'équivalent de 42 millions de dollars US de recettes fiscales grâce au cannabis sur l'exercice 2019/2020, s'est engagé à consacrer 100 millions à la prévention et la surveillance pendant les six ans suivant la légalisation.
En Uruguay, "il n'y a pas eu de boom économique", observe Mme Obradovic, car l'Etat a gardé un contrôle très fort et "n'a jamais voulu faire du profit sur l'économie du cannabis".
rfo/pa/mpm


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
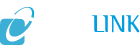
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)