Grégory Villemin, Estelle Mouzin, Virginie Bluzet... 36, 18 et 23 ans d'enquête respectivement, sans que personne n'ait à ce jour été condamné. Face au chemin de croix des familles de victimes, des voix s'élèvent pour améliorer en France le traitement des "cold cases".
Marie-Rose Blétry en sait quelque chose. A 20 ans, sa fille, Christelle, a été violée et tuée un soir de décembre 1996 de 123 coups de couteau en Saône-et-Loire. "J'ai attendu 18 années pour savoir qui avait tué ma fille. 18 années, c'est 17 de trop", souffle-t-elle.
Des années durant, cette femme s'est démenée pour que soit retrouvé le meurtrier de sa fille. Elle raconte le travail bâclé lors des constatations sur place et de l'autopsie, l'indifférence voire l'hostilité du premier juge d'instruction chargé de l'affaire, les fausses pistes privilégiées par les enquêteurs...
C'est finalement grâce à une nouvelle analyse des vêtements de sa fille, qu'elle réclamait à cors et à cris, qu'un ouvrier agricole, Pascal Jardin, a été confondu en 2014 par son ADN. Il a été condamné trois ans plus tard à la perpétuité, une peine confirmée en appel.
Si cette affaire a fini par être résolue, une multitude de "cold cases" n'ont toujours pas connu leur épilogue en France et de nombreuses familles se battent pour empêcher que les enquêtes se soldent par des non-lieux.
- Pas de statistique -Difficile d'évaluer leur nombre, admet Jacques Dallest, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble. Le magistrat est à l'origine d'un groupe de travail à la Chancellerie qui devrait présenter dans quelques semaines des recommandations pour améliorer le traitement judiciaire de ces affaires non-résolues.
A l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), les enquêteurs travaillent actuellement sur une trentaine de dossiers, tandis que la toute nouvelle division "cold case" de la gendarmerie, lancée à l'automne 2020, a identifié 80 dossiers, dont six qu'elle suit à temps plein.
"On nous dit souvent: vous n'avez pas beaucoup de résultats sur les +cold cases+", observe Philippe Guichard, qui fut le chef de l'OCRVP pendant six ans. "Avec les années, il est plus difficile d'enquêter, les preuves s'estompent les unes après les autres", reconnaît le policier, membre du groupe de travail de la Chancellerie. "Mais j'ai l'habitude de dire que quel que soit le dossier, rien n'est perdu", ajoute-t-il. "A partir du moment où on se réintéresse à un dossier, on peut trouver la solution, même 5, 10, 15, 20 ans après. Il y a toujours des éléments qui apparaissent, même longtemps après."
Parmi ces affaires, un certain nombre sont liées à des tueurs en série, soutient Didier Seban, qui défend avec sa consoeur Corinne Herrmann plusieurs familles de victimes.
Or, selon l'avocat, la France s'interdit d'appréhender dans son ensemble le parcours des tueurs en série, en enquêtant sur des faits précis et non sur des individus. "On ouvre une information judiciaire à chaque fois qu'il y a un crime ou plus rarement pour une disparition suspecte" mais on ne recherche pas systématiquement de lien avec les enquêtes ouvertes dans d'autres juridictions, déplore-t-il.
- Juges spécialisés -"Il faudrait des juges spécialisés, susceptibles de se saisir du parcours d'un homme, pour le reconstituer", plaide Me Seban. Un peu à l'instar de ce qu'a ébauché la juge d'instruction parisienne Sabine Khéris qui, depuis l'été 2019, a récupéré la direction des investigations sur quatre disparitions et meurtres liés à Michel Fourniret et a réussi à obtenir des aveux du tueur en série notamment dans l'affaire Estelle Mouzin.
"On a du mal à faire des rapprochements entre les affaires, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe aux quatre coins de la France", confirme Jacques Dallest, qui aimerait "que dans les tribunaux disposant de pôles criminels, les dossiers soient tracés, qu'on ait une forme de mémoire criminelle informatique".
Autre raison empêchant le rapprochement entre les affaires, la concurrence entre police et gendarmerie.
Me Seban appelle aussi à la création d'un fichier sur l'ADN des victimes, qui permettrait de le relier au parcours de criminels dont on aurait retrouvé une trace.
De même, il se bat depuis des années pour améliorer la conservation des pièces retrouvées sur les lieux du crime, en les répertoriant notamment via un système de code-barres.
"On a une politique de conservation des scellés parfaitement scandaleuse. A Grenoble, ils ont été incapables de retrouver le squelette d'un enfant. Dans l'enquête sur Estelle Mouzin, on sait qu'un sac de viennoiserie avait été trouvé par terre, mais il a disparu", déplore-t-il, regrettant par ailleurs que les scellés soient détruits après les procès et six mois après les non-lieux.
edy-tll/jt/cbn


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
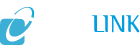
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)